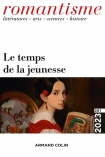Romantisme n° 171 (1/2016)
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
L’emploi métaphorique du verbe ciseler et de ses dérivés, ciselé(e), ciselure, appliqué à la phrase, au vers, au sonnet, a été inauguré par des écrivains journalistes, au tout début de la monarchie de Juillet, avant de se répandre sous le Second Empire et d’acquérir le statut de cliché qu’on lui connaît aujourd’hui. Nous examinons les conditions d’apparition de la métaphore, ses variations de sens selon l’objet évalué ainsi que les conceptions esthétiques qu’elle induit dans l’éloge ou le blâme. Notre étude conduit à infirmer l’hypothèse selon laquelle la métaphore du poète ciseleur aurait été inaugurée par le Parnasse dans les années 1860 : elle est bien antérieure et paraît liée à l’idée de ce que Barthes a appelé la « concrétion » d’une langue littéraire, plus raffinée ou cherchant l’effet, qui naît vers 1830.
L’emploi métaphorique du verbe ciseler et de ses dérivés, ciselé(e), ciselure, appliqué à la phrase, au vers, au sonnet, a été inauguré par des écrivains journalistes, au tout début de la monarchie de Juillet, avant de se répandre sous le Second Empire et d’acquérir le statut de cliché qu’on lui connaît aujourd’hui. Nous examinons les conditions d’apparition de la métaphore, ses variations de sens selon l’objet évalué ainsi que les conceptions esthétiques qu’elle induit dans l’éloge ou le blâme. Notre étude conduit à infirmer l’hypothèse selon laquelle la métaphore du poète ciseleur aurait été inaugurée par le Parnasse dans les années 1860 : elle est bien antérieure et paraît liée à l’idée de ce que Barthes a appelé la « concrétion » d’une langue littéraire, plus raffinée ou cherchant l’effet, qui naît vers 1830.