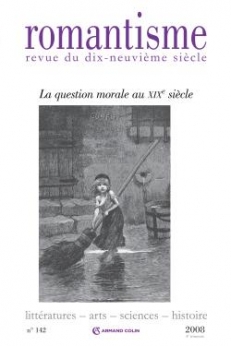
Romantisme n° 142 (4/2008)
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
Au lendemain de la Révolution française et dans l’esprit de philanthropie des Lumières, une nouvelle politique pénale se met en place qui substitue l’enfermement aux châtiments corporels. Comme le montre le débat entre Alexis de Tocqueville et Charles Lucas dans les années 1840, il s’agit d’une véritable « utopie pénitentiaire » qui met au centre la notion religieuse de pénitence : on attend du condamné qu’il s’amende par l’effet conjugué de l’isolement en cellule qui favorise la réflexion, du travail, qui occupe et de la religion qui console. Mais les questions de coût, la volonté d’une répression de plus en plus dure, allant jusqu’à la transportation, la comparaison avec le sort des travailleurs pauvres, et vers la fin du siècle, la prise en compte de la dimension sociologique de la délinquance ont conduit à l’échec de cette politique qui partait de la libre volonté de l’individu dans un univers contraint.
After the French Revolution, and according to the philanthropic spirit of Enlightenment, a new penal policy is implemented, which tends to replace cruel corporal chastisements by confinement, solitude and imprisonment. In the debate with Charles Lucas in the 40’ Alexis de Tocqueville defines an utopian project for prisons, with, at the center, the religious notion of penance. The condemned person is expected to amend thanks to the isolation in the cell, the occupation due to work and the consolation of religion. But the permanent financial objections, the will to punish harder the culprits, even by transportation, the comparison with the general fate of the poor and, at the end of the century, the sociological interpretation of crime condemn this liberal-minded reform to failure : it was built on the free will of the prisoners, in what was an essentially repressive environment.

